

Ordre mondial et état d'exception
Source : Reyes Mate
« Le droit des gens ne tient pas seulement sa valeur d'un pacte ou d'un accord entre les hommes, mais il a aussi valeur de loi. Car le monde entier, qui forme d'une certaine manière, une seule communauté politique, a le pouvoir de faire des lois justes et bonnes pour tous, comme celles qui se trouvent dans le droit des gens. Il en ressort clairement que ceux qui violent le droit des gens, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, commettent un péché mortel, mais à condition que ce soit sur des points assez importants, comme l'immunité des ambassadeurs. Et il n'est permis à aucun État de refuser de se soumettre au droit des gens, car c'est en vertu de l'autorité du monde entier qu'il a été établi » (1) .
Ces quelques lignes de Francisco de Vitoria présentent les principales caractéristiques de ce qu'il appelle le droit des gens. Ce dernier se fonde sur un accord entre les hommes et les nations qui a force de loi. Ainsi, le juste n'est pas juste en lui-même ou suivant le droit naturel, mais « par un statut humain fixé par la raison » (2) . En d'autres termes, le droit des gens est un droit positif, qui relève d'un accord « tacite entre les nations », dont le fondement est rationnel. Mais de quelle rationalité parle-t-on ici ? Selon la théorie thomiste, la rationalité de la loi correspond à un ordre rationnel dont le but ultime est le bien commun. Or si le bien commun représente l'objectif du droit des gens, il doit alors prévaloir, notamment lors de conflits entre des États particuliers, et un État représentant le « monde entier » doit, par ailleurs, pouvoir déclarer la guerre à un autre État si ce dernier porte atteinte au bien commun de son peuple. Vitoria ne dit pas « se substituant au monde entier », mais bien « représentant le monde entier ». Or il est très difficile aujourd'hui de suivre ce principe, étant donné que le bien commun se conçoit désormais en termes de démocratie et de droits de l'homme. En effet, ces nouvelles formes de bien commun ne peuvent se réaliser que par la participation des intéressés. On ne voit pas vraiment comment un État pourrait imposer par la force la démocratie à un autre État.
Selon Vitoria, le droit des gens est un droit positif qui découle du droit naturel, autrement dit, c'est une adaptation du droit naturel aux circonstances historiques. Cela mérite quelques explications. Le droit naturel vient du mythe ou de la conviction que tous les hommes naissent égaux. Or désormais cet état naturel ou de naissance n'existe plus dans notre société, car les hommes naissent aujourd'hui inégaux. Le droit des gens viendrait ainsi pallier ce désordre social, mais d'une manière bien particulière. Rappelons, en effet, que le désordre social ou les inégalités sociales sont liés un problème de justice ou d'équité. On pourrait ainsi attendre d'un système politique mû par un souci de justice qu'il prenne en charge ces injustices. Mais Vitoria a le sentiment que c'est là une voie dangereuse, et il choisit donc de faire de nécessité vertu, c'est-à-dire de voir dans les inégalités une condition de la paix. À propos des inégalités, il dit donc « qu'elles aident certainement à la paix et à la concorde des hommes, qui ne pourraient pas subsister s'ils n'avaient pas chacun des biens déterminés ; et par conséquent il est conforme au droit des gens que les possessions soient divisées » (3) . D'une part, nous sommes donc conscients que la propriété privée porte atteinte à l'égalité naturelle, mais d'autre part, celle-ci devient le principe de la vie en commun. Ce détournement de Vitoria, que Rousseau élèvera au rang de stratégie politique de la modernité, signifie pour l'instant que le droit des gens n'a pas pour objectif la justice mais la paix ou, plus encore, l'ordre d'une paix en marge de la justice.
1. Du droit des gens à l'état d'exception
Il faudrait se demander dans quelle mesure le nouvel ordre mondial qui a vu le jour avec le 11 septembre 2001, entraîne la liquidation du droit des gens. Mais observons d'emblée que le 11 septembre représente peut-être l'accélération d'un processus qui vient de loin. Je veux parler ici du phénomène qualifié de « révolution conservatrice », qui est conservateur car la sécurité y est privilégiée par rapport à la liberté, et révolutionnaire car il s'agit de se séparer d'un ordre dont on considère qu'il a périclité. Ce processus n'exclut pas la violence, bien que le nouvel ordre, une fois établi, compte bien être validé par le droit, étant donné la facticité innée caractérisant celui-ci.
Or le nouvel ordre se définit par l'état d'exception décrété par la première puissance mondiale sur le « monde entier », dans la mesure où quelqu'un ou quelque chose représente une menace pour l'empire. Certes, l'exceptionnalité n'a pas été décrétée de manière officielle, mais les documents à l'appui de cette thèse ne manquent pas. Ainsi, le texte intitulé « Stratégie nationale de sécurité des États-Unis » (novembre 2002) contient déjà les éléments fondamentaux de ce nouvel ordre : doctrine de l'action préventive, dénonciation du danger représenté par les États « irresponsables » dotés d'armes de destruction massive (étant entendu que les États « responsables » pourvus des mêmes armes ne représentent aucun danger), engagement de maintenir la supériorité militaire des États-Unis et de protéger les citoyens américains devant le Tribunal pénal international…
Un autre document antérieur, le Décret militaire du 13 novembre 2001, signé par le président Bush, permet de mieux comprendre le caractère exceptionnel de cette politique. En vertu de ce texte, tout ressortissant étranger suspect de terrorisme est soumis à une juridiction spéciale, et peut notamment être maintenu en détention indéfiniment et jugé par des commissions militaires exemptes de tout contrôle juridique. Ces principes « juridiques » peuvent entraîner les effets suivants: en premier lieu, la suspension du droit et, par conséquent, la réduction du suspect ou du détenu à la « vie nue ». Les détenus de Guantánamo constituent l'exemple le plus évident d'une situation où la loi se retire du sujet, non pas pour le libérer, mais pour le priver précisément de sa condition de sujet. Officiellement, ces personnes ne sont accusées de rien en particulier, elles ne sont pas non plus considérées comme des prisonniers de guerre, elles ne peuvent se pourvoir devant aucun tribunal qui les accuserait, elles sont jugées sans être accusées. Elles sont donc condamnées à être traitées comme des non-sujets et il faudrait évoquer le Procès de Kafka pour comprendre ce dont il s'agit ici.
En second lieu, l'entrée en scène de la figure de l'invasion en tant que nouvelle forme de l'opposition entre ami et ennemi définit, selon Carl Schmitt, le politique. L'invasion, quatrième chevalier de l'apocalypse, aux côtés de la faim, de la guerre et de la peste, invalide les efforts civilisateurs qui, pendant des siècles, ont cherché à atténuer les dommages entraînés par la guerre en suscitant, par exemple, le débat sur la « guerre juste ». Il est, en effet, impossible de juger une invasion moderne au moyen des catégories de la guerre juste (motif suffisant, autorité compétente et juste finalité) car, par définition, cette notion appartient à l'ordre ancien, conçu comme dépassé. Jürgen Habermas (4) (5) . Il ne supporte pas que Vitoria fasse du problème de la guerre juste le centre de son analyse sur le droit des gens. Selon lui, la moralisation de la guerre, qui préoccupait tant l'École de Salamanque, laisse échapper l'essentiel, à savoir la valeur structurelle de la guerre dans la construction de l'État. Concevoir la guerre hors de ce cadre, et commencer à évoquer des guerres justes et injustes, conduirait ainsi, en cas de guerres injustes (qui seraient les plus nombreuses), à lever tout frein à la violence, car la moralité est impuissante face à la dynamique de la barbarie. En vertu de cette théorie, l'hostis n'est ni bon, ni mauvais, il représente un moment nécessaire du jeu politique et, en tant que tel, mérite le respect. Si au contraire, nous le moralisons et le déclarons mauvais, alors nous pouvons tout faire avec lui, et de même, lui avec nous. La moralisation de la guerre annoncerait donc, selon Schmitt, la barbarie. Une fois que l'on a affirmé la valeur structurelle de la guerre, la relation Schmitt-Benjamin est au cœur du débat (6) . Celui-ci est sous-tendu par la conviction que partagent les deux intellectuels selon laquelle il y a un rapport entre droit (ou politique) et violence. Le droit, nous dit Benjamin, naît et se maintient grâce à la violence. Cela semble paradoxal, mais la politique, c'est-à-dire l'institution que l'homme invente pour la vie en commun, repose sur la violence. Telle est sa préoccupation de départ.
Selon Benjamin, la suspension du droit ou l'état d'exception dessine la figure qui pourrait résoudre l'énigme et nous rapprocher d'une politique non violente. Cela nous permettrait de libérer la vie spontanée ou la vie en commun normale de son corset conventionnel. Afin de nous faire une idée de ce que serait cette politique sans normes, il faut penser au carnaval, un moment exceptionnel où la société se sent libre car elle suspend les normes conventionnelles qui règlent habituellement la vie en commun. Ce même état d'exception peut évidemment produire un effet pervers, si le souverain, tout en libérant ses sujets de la loi, ne leur donne pas la liberté, mais leur impose une soumission sans loi. La loi se retire alors, mais les sujets restent à la merci du souverain. C'est ce qui arrive à Guantánamo et ce qui aura lieu systématiquement dans les camps de concentration ou d'extermination.
Benjamin est à la recherche d'une figure de l'exception qui parviendrait à libérer la vie sans tomber dans l'arbitraire ou le décisionnisme du souverain. Tel est le sujet de Zur Kritik der Gewalt. Il y distingue d'une part une violence mythique, propre au droit et se caractérisant par le combat avec les violents au moyen de leurs propres armes, ce qui entraîne inévitablement la reproduction de la violence, et d'autre part, une violence divine, qui consisterait à nier la négation, c'est-à-dire à combattre l'injustice avec la justice et non pas avec l'injustice. Nous serions ici face à une conception de la politique tournant autour de l'axe de la justice, entendue comme négation ou interruption de l'injustice. Cette violence divine ne lie pas la politique au droit ; elle le soumet à la justice, dans la mesure où la source de la justice est l'expérience de l'injustice.
Carl Schmitt poursuit le débat ouvert par Benjamin, mais ses préoccupations sont différentes. Ce n'est pas la violence du pouvoir qui l'inquiète, mais l'explication du pouvoir. La figure de l'état d'exception lui en donne la clé. Lorsqu'il écrit « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle » (7) , il pense avoir trouvé un fondement solide du pouvoir qui transcende les velléités de la volonté générale, en s'apparentant au pouvoir divin. Le pouvoir se fonde sur la décision du souverain qui n'est jamais aussi pure et inconditionnée que lorsque celui-ci déclare l'état d'exception, car alors la norme est suspendue et tout reste à la merci de sa décision. Cependant, la pensée conservatrice de l'auteur est rebutée par une caractéristique de l'état d'exception : le fait que les intéressés soient libérés du droit, et qu'ils puissent penser que la vie est anomique. Le conservateur Schmitt ne peut pas accepter que la politique soit un carnaval, car cela impliquerait le chaos. Il redessine ainsi cette figure exceptionnelle et la suspension du droit se transforme en une dépendance inconditionnée des sujets à la volonté du souverain qui acquiert « force de loi » (8) .
Mais le problème se posant à Carl Schmitt est le suivant : sa théorie ne peut fonctionner que si l'exceptionnalité de l'état d'exception est maintenue, car l'inverse signifierait le chaos. En effet, le camp peut être une cité sans loi (comme l'étaient les camps nazis), à condition que la loi fonctionne dans le reste du pays, de manière à ce que grâce à la loi, on puisse envoyer des gens dans le camp, empêcher quiconque d'être solidaire avec les déportés, former des polices fidèles s'identifiant à la solution finale, etc. Guantánamo peut exister dans la mesure où existe un Capitole. L'exceptionnalité n'a pas pour prétention que l'ensemble du territoire soit un Guantánamo, mais que tout suspect puisse être envoyé à Guantánamo.
La théorie de Carl Schmitt est donc marquée par un chaos latent qu'il cherchait précisément à éviter. Le dernier Benjamin se sert de cet argument pour rejeter la proposition schmittienne qui a pour unique souci de laisser les mains libres au souverain, et non la liberté/libération des citoyens. Benjamin dit à Schmitt qu'exceptionnalité et souveraineté sont incompatibles, car ce sont des concepts alternatifs : l'affirmation de l'un suppose la négation de l'autre. En effet, Schmitt veut une « souveraineté décisionniste », c'est-à-dire une discrétionnalité permanente. Or si elle est permanente, elle n'est pas exceptionnelle.
Que se passe-t-il en cas de discrétionnalité permanente ? L'objet de cette discrétionnalité vit dans un état d'oppression lui aussi permanent, c'est-à-dire qu'une négation de la politique se produit. Il ne faut pas confondre la négation de l'autre (un autre peuple, un autre État), à laquelle se réfère la dialectique ami-ennemi, et la négation d'une partie de son propre peuple, ce qui revient à nier le politique. Or c'est bien ce qui s'est passé au cours des siècles, et que Benjamin a résumé par cet énoncé : « pour les opprimés, l'état d'exception est la règle » (9) . Benjamin n'énonce pas là un jugement moral, mais formule la critique la plus destructrice du décisionnisme, car celui-ci suppose la négation de ce qu'il cherche précisément à affirmer. Le décisionnisme voulait proposer une alternative à la faiblesse politique du libéralisme dont la légitimité se fonde sur une chose aussi fragile que la volonté des citoyens, et finit par nier à la moitié du peuple son existence politique. Le décisionnisme de Schmitt assure la pérennité de ce qu'il voulait éliminer : la guerre civile dans l'État.
3. La proposition de Benjamin est la suivante : déclarer l'état d'exception à cet état d'exception permanent. On retrouve ici une idée chère à Franz Rosenzweig, pour qui l'État représentait la fixation d'un moment de la vie des peuples. C'est comme si l'État voulait arrêter le temps et empêcher à la vie de suivre son cours. Mais la vie continue, d'où la tension entre État et vie. Pour Benjamin, la politique est du côté créatif de la vie, tandis que le droit est lié à la volonté d'arrêter le rythme vital. Rendre exceptionnel l'état d'exception permet d'interrompre cette logique ankylosée qui est un éternel retour du même, sans nouveauté possible. Étant donné que pour Benjamin le progrès est un retour du même, nous pouvons penser que sa théorie du « véritable état d'exception » n'est pas seulement une réponse à Schmitt, mais aussi à la logique qui sous-tend une idée en principe opposée au conservatisme schmittien, à savoir le progrès. Il y a un lien de parenté entre la logique schmittienne (y compris dans sa version fasciste) et le progrès (10) .
Le progrès est un retour constant du même, qui n'est marqué par aucune nouveauté, à la manière de l'extension d'un continuum. Tant que le présent est le résultat du passé victorieux, le futur ne pourra être que la projection du donné. Ce qui a toujours été revient, car ce qui a été continue à être. La nouveauté ne pourrait intervenir que si l'on rendait présent ce qui n'a pas été, c'est-à-dire la part frustrée ou échouée de l'histoire. Il ne faut pas croire cependant que Benjamin soit un vieillard archaïque qui déteste le progrès ; il dénonce simplement la non nouveauté et par conséquent l'inhumanité du progrès. Cela ne revient pas au même, en effet, de faire de l'humanité l'objectif du progrès, ou du progrès le moyen au service de l'humanité. Dans le premier cas, le progrès se transforme en un idole social auquel tout doit être sacrifié ; dans le second, il constitue le moyen d'une amélioration de l'humanité, laquelle marquera le rythme et les objectifs du progrès.
Si nous revenons maintenant à l'idée du droit des gens, nous nous apercevrons que celui-ci est non seulement nié de manière frontale par Carl Schmitt, mais aussi remis en question par Walter Benjamin. Ce droit est au fond compatible avec Guantánamo, car il se préoccupe de l'ordre et non de la justice. Cependant, entendons-nous bien : Guantánamo ne signifie rien de particulier par rapport au droit des gens, mais celui-ci rend possible la huitième thèse, selon laquelle pour les opprimés, l'état d'exception est permanent.
4. Nous nous trouvons, par conséquent, face à deux modèles distincts d'ordre politique : l'un tend à préserver l'ordre et l'autre à assurer la justice. Bien qu'ils semblent complémentaires, ils sont en réalité alternatifs. Ben Ami, l'ancien ambassadeur israélien en Espagne, le déclarait récemment de manière frappante et assez inhabituelle. Il disait ainsi à propos de la crise israélo-palestinienne : « si la justice triomphe, la paix sera impossible ». Ou encore : « les Palestiniens ne sont pas capables d'accepter le degré d'injustice nécessaire à l'obtention d'une solution raisonnable et pratique » (11) . Le message est clair : la paix ou bien la justice. Contrairement à ce que la logique voudrait, la réponse à l'injustice ne décourage pas celui qui engendre de nouvelles injustices, mais au contraire encourage la perpétuation de nouvelles injustices. C'est ainsi qu'est liquidé d'une formule le principe selon lequel « il faut se souvenir (de l'injustice) pour que l'histoire (des injustices) ne se répète pas ». Ces deux modèles ne sont ni complémentaires ni compatibles, car l'origine et l'essence de cette conception de la politique n'est autre que la théologie politique schmittienne.
Le concept ancien de « théologie politique » ressurgit dans la modernité lorsque l'idée moderne du politique entre en crise. La politique moderne était caractérisée par sa prétention d'universalité et les valeurs politiques touchaient l'humanité même : les droits de l'homme, la citoyenneté, l'égalité entre tous les hommes etc. Cet humanisme avait même gagné la religion, si bien qu'un discours théologique n'ayant pas pactisé au préalable avec la raison n'était pas pris au sérieux. Le phénomène concernait aussi bien le christianisme (pensons au protestantisme libéral) que le judaïsme (les théories sur la « germanité et la judéité » du néo-kantien Hermann Cohen en sont un bon exemple). Or il arrive un moment où cet ordre ressemble à une coquille vide. L'homme universel est impossible. Personne n'est citoyen du monde, car cela signifierait la perte de la possibilité d'être étranger quelque part, l'étrangeté ayant toujours été et demeurant le principe de l'universalité. Ainsi, non seulement l'homme abstraitement universel se perd, mais il est également incapable de faire face aux courants déstructurants que représentent les nationalismes ou la partitocratie de Weimar. C'est dans ce contexte qu'apparaît, du côté protestant, la théologie dialectique affirmant son identité en vis-à-vis et contre cet humanisme rationaliste vide, et du côté de la philosophie politique, « la théologie politique » de Carl Schmitt.
Schmitt n'est pas un théologien, mais un juriste qui, cela dit, remet en cause les principes de légalité et de légitimité en vigueur dans le champ politique, au moyen de trois thèses qui font l'effet d'un coup de tonnerre : « tous les concepts de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés », « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle » et « le politique consiste en un affrontement ami-ennemi ». La première thèse représente une déclaration de guerre à la laïcité, c'est-à-dire à l'autonomie supposée d'une politique — la politique moderne — dont la substance est pourtant issue de la théologie. La deuxième constitue un plaidoyer contre la politique entendue comme un consensus délibératif ; au « parlement » est opposée la décision. La troisième thèse, qui devrait être la première, replace l'ordre que cette théologie politique est supposée défendre dans un contexte de belligérance où sont estompées les frontières entre l'ordre et le désordre. Nous nous permettons d'englober ces différentes thèses de Schmitt sous l'expression de « théologie politique », car elles partagent toutes le même sol théologico-politique. Je voudrais maintenant en commenter au moins les points indispensables permettant d'éclaircir notre propos.
Carl Schmitt se présente lui-même comme un penseur politique catholique. Il ne faut pas entendre ici le mot catholique comme un adjectif (comme dans l'expression « démocratie chrétienne », où « chrétienne » renverrait à une variante possible de la démocratie), mais comme un substantif, la politique se nourrissant du catholique. Cependant, qu'entend Carl Schmitt par catholique ? Le catholicisme correspondrait à une compréhension gnostique du monde. Cela mérite une explication, car le gnosticisme est une hérésie, c'est-à-dire une modalité explicitement rejetée par l'orthodoxie catholique. Mais on n'est pas toujours libre de ce que l'on rejette. J.B. Metz parle du gnosticisme, représenté par Marcion, comme d'une « tentation permanente de la théologie chrétienne » (12) . Or Schmitt ne tombe pas dans cette tentation, mais l'élève au rang de catégorie. Marcion offre une issue à la frustration des premiers chrétiens qui attendaient en vain le retour du Messie, en faisant disparaître toute trace temporelle de salvation. La salvation est atemporelle et le temps n'apporte pas la salvation. Cela signifie qu'il ne faut pas lier l'injustice de ce monde à la justice de Dieu, l'injustice ayant sa logique, distincte de celle de la justice. Marcion introduit le dualisme d'un Dieu qui se charge du bien (le Dieu salvateur) et d'un autre qui se charge du mal (le Dieu créateur).
Le christianisme rejette cette hérésie des deux dieux, mais en paie le prix, c'est-à-dire qu'il trivialise l'idée du temps, du temps limité, eschatologique. Le temps n'intervient en rien dans l'idée de la salvation. Il faut compter sur un temps perpétuel et, par conséquent, rejeter l'idée d'une salvation liée à une fin qui signerait l'interruption du continuum du temps. Nous avons là un élément fondamental du gnosticisme : le rejet de toute idéologie laissant supposer que la salvation est un attentat venant interrompre le cours du temps, c'est-à-dire le rejet de l'idée de révolution, de changement, d'interruption. Ce que disait Tertullien vaut aussi pour Schmitt, à savoir que « nous prions pour retarder la fin » . L'abandon du temps eschatologique représente le triomphe de toutes ces conceptions où le temps ne signifie rien, car il y a toujours du temps : l'éternel retour, l'évolutionnisme, le progrès etc . Schmitt renforce cette idée conservatrice du présent en affirmant que le Messie est déjà venu, et qu'il faut donc renoncer à de nouvelles convulsions messianiques. Notre temps est celui de la salvation. Pour exprimer son interprétation du monde, Schmitt oppose les termes de katechon (kat-echon = arrêter le présent ou maintenir le donné) et d'eschatologie (la salvation est à la fin).
Comment cela se traduit-il politiquement ? Tout d'abord, par une reconnaissance de la valeur du présent, contre tout pari sur le futur ou sur un changement. Ensuite, par une transposition du dualisme gnostique (principe du bien et principe du mal) dans le champ du politique défini comme « l'affrontement entre l'ami et l'ennemi ». Il s'agit bien d'affrontement et non de « distinction », contrairement à la traduction que l'on donne généralement du terme Unterscheidung. N'oublions pas que nous sommes ici sur le terrain politique et non moral. Ainsi, il ne faut pas faire des termes « ami » et « ennemi » des catégories psychologiques (Schmitt dit que l'on ne peut pas traduire ennemi par inimicus), mais politiques (hostis). L'ami représente ma collectivité, mon peuple, ceux qui partagent le même sang et la même terre ; l'ennemi, c'est l'autre, l'autre peuple. « L'ennemi, c'est l'autre » . Cette division qui oppose les relations d'amitié entre semblables aux relations d'inimitié ou de guerre entre peuples s'inscrit dans la théorie et la pratique occidentale.
Hegel en parle, et avant lui, Rousseau : « d'homme à homme nous vivons dans l'état civil et soumis aux lois ; de peuple à peuple, chacun jouit de la liberté naturelle » . Ce que Todorov explicite ainsi : « entre pays les rapports restent dans l'état de nature ; dans chaque pays règne en revanche l'état de société » . Si nous nous demandons pourquoi le bon nous caractérise, et le mauvais caractérise l'autre, il faut répondre, non pas parce que nos semblables sont bons ou meilleurs, mais parce qu'il nous suffit d'être là pour être. Nous n'avons pas besoin de changer. Celui qui éprouve le besoin de se soumettre à un changement, éprouve ce besoin parce qu'il se situe au mauvais endroit. Cependant, le changement ne lui convient pas, il lui advient. Il ne peut pas y avoir d'amitié entre celui qui est acteur du changement parce qu'il se sait déjà à l'endroit où il faut être, et celui qui doit se soumettre au changement parce qu'il ne se situe pas au bon endroit. Leur relation est marquée par l'inimitié .
Nous avons donc une théologie politique d'origine gnostique, qui se traduit par la conservation de l'état des choses, ainsi que par un rapport entre les peuples caractérisé par l'« affrontement entre ami-ennemi ». Selon cette conception du politique, les relations internationales doivent être conçues comme une guerre civile mondiale d'un État contre un autre et, s'il est très puissant, de cet État contre tous. L'État puissant ne cherche pas à imposer aux autres une certaine légalité, mais une décision qui suspende toute légalité. Todorov s'amuse ainsi à critiquer ceux qui ont dénoncé l'illégalité de la guerre en Irak. Pour une raison simple : les relations internationales ne sont pas régies par le droit, mais par un ordre international, « fait de traités, de conventions et aussi de participation aux organisations internationales ; mais cet ordre n'est pas garanti par une police mondiale – celle-ci n'existe pas plus que l'État universel. C'est pourquoi il est un peu futile de parler, comme on l'a fait au moment du conflit irakien, de « guerre illégale ». Dans sa définition même, la guerre – toute guerre – est une rupture de l'ordre international préexistant ; mais celui-ci n'a jamais eu puissance de loi » . Schmitt abonderait en ce sens et ajouterait que cet ordre international n'est pas le résultat d'un accord, mais qu'il est imposé par le plus fort grâce à l'état d'exception. La suspension de la légalité que chaque « ennemi », autrement dit chaque État différent, construit représente le chemin vers un ordre mondial qui mettrait en sourdine cette structure politique définie comme un affrontement ami-ennemi.
5. Mais à quoi est-ce que cela aboutit ? À un nouveau diagnostic de ces pathologies politiques appelées dictatures, totalitarismes ou fondamentalismes. Le problème n'est pas extérieur, dans des traditions allergiques à la démocratie, comme on le dit souvent à propos de l'islam, mais intérieur à notre propre culture. La théologie politique schmittienne vit de ces pathologies, en faisant de l'autre un ennemi et de la déclaration de l'état d'exception l'acte politique par excellence (l'exercice de la souveraineté). Il existe une complicité étrange entre Bush et Schmitt, bien que le Président américain n'ait jamais entendu parler du juriste allemand. Par-delà les connivences entre Bush et certains mouvements intégristes religieux qui soutiennent sa stratégie de politique extérieure et intérieure, ce qui réunit les deux hommes c'est, d'une part, une conception de la politique où les États-Unis conçoivent l'état du monde en termes d'ami-ennemi, et d'autre part, une manière d'exercer la souveraineté sur « l'autre » (le reste du monde) par l'imposition d'une décision propre qui entraîne la suspension du droit étranger. Dans les premiers temps de la deuxième guerre mondiale, alors que les camps étaient encore presque clandestins, des voix s'élevaient déjà pour dire « toute l'Europe est une camp ». Accepter que la loi soit suspendue à titre exceptionnel quelque part, c'est reconnaître que tout droit peut être marqué par l'exceptionnalité et, par conséquent, que chacun, groupe ou peuple, est susceptible d'être réduit à l'état d'exception. Si nous tournons la page, au nom du sens pratique, c'est-à-dire si nous cessons de dénoncer « l'illégalité » et « l'illégitimité » de la guerre pour collaborer avec l'envahisseur, nous ne ferons ainsi qu'encourager ceux qui dans les bureaux du pouvoir indiquent en ce moment même le lieu d'une nouvelle opération militaire.
Traduit de l'espagnol par Aurélien Talbot
------------------------------
(1) Francisco de Vitoria, Leçon sur le pouvoir politique, Vrin, Paris, 1980, p.73-74. Cf. le commentaire de F. Castilla (1992) El pensamiento de Francisco de Vitoria, Anthropos, Barcelona, p.161.
(2) Francisco de Vitoria, Comentariosa la II II p. 57, a. 3, n.1 (édition de Beltrán de Heredia, Biblioteca de Autores Católicos, Salamanca 1932-35, vol. III, p.12)
(3)Francisco de Vitoria, Comentarios a la II II, 57,3,1, p.12
(4) J. Habermas « Europa: en defensa de una política exterior común» [Pour une politique extérieure commune européenne], El País du 4 juin 2003
(5) Cf. Carl Schmitt, Le Nomos de la terre dans le droit des gens du Jus publicum europaeum, PUF, Paris, 2001
(6) Sur ce thème, l'ouvrage de Giorgio Agamben, L'état d'exception, Seuil, Paris, 2003, est indispensable.
(7) Sur la conception schmittienne de la politique et pour les références des citations évoquées ici, je me permets de renvoyer à Reyes Mate, « Mémoire et barbarie. L'impératif catégorique d'Adorno », Les Temps Modernes, n°630-631, mars-juin 2005, Gallimard, Paris.
(8) C'est ce qu'étudie J. Derrida dans Force de Loi, Galilée, Paris, 1994.
(9) W. Benjamin, Gesammelte Schriften, I/2, p.697
(10) Benjamin, « ce n'est pas la moindre des chances du fascisme que ses adversaires le combattent au nom du progrès », GS, I/2, p.697
(11) Je cite ici textuellement les propos de Shlomo Ben Ami, parus dans l'entretien que lui consacre El Periódico de Catalunya (« ¡Europa, basta ya de criticar a Sharon! » [L'Europe doit maintenant cesser de critiquer Sharon !]) du 25 février 2004, p.9. Cet homme, si raisonnable en temps normal, est victime d'une grave confusion : il confond ici les conditions pratiques de la paix et la négociation sur les principes. Si Ben Ami reconnaît qu'il était injuste d'expulser les Palestiniens, alors de deux choses l'une : a) ou bien on fait justice à cette injustice (en les laissant revenir ou en tombant d'accord sur un moyen de leur donner satisfaction ou une réparation) b) ou bien on construit une paix « violente » qui entraîne obligatoirement la reproduction de la violence.
(12) J.B.Metz «Teología contra polimitismo o breve apología del monoteísmo bíblico» dans J.B Metz (1999) Por una cultura de la memoria, Anthropos, Barcelona, p.150 y ss
(13) Tertullien, Apologeticum, 39. Cité par J. Manemann, Carl Schmitt und die Politische Theologie, Aschendordff Verlag, Münster, 2002, p.170
(14) Rien n'éclaire mieux cette banalisation du temps que la nouvelle de Kafka intitulée « La muraille de Chine ». L'auteur y raconte que la construction de la Tour de Babel n'a pas échoué à cause de la confusion des langues, contrairement à ce que dit la Bible. En réalité, la première pierre n'a jamais été posée car, étant donné qu'il y avait toujours le temps, il n'y avait aucun besoin de commencer…
(15) C. Schmitt (1950) Ex captivitate salus. Erfahrungen der Zeit 1945-47, Köln, p.90
(16) J.J. Rousseau, Œuvres Complètes, (éd. de la Pléiade) III, p.510
(17) T. Todorov, Le nouveau désordre mondial. Réflexions d’un Européen, Robert Laffont, Paris, 2003, p.65
(18) « Le maître d'un monde à changer, c'est-à-dire d'un monde raté (à qui l'on impose une nécessité de changement parce qu'il ne se résigne pas à changer mais au contraire s'y oppose), et le libérateur, le fauteur d'un monde transformé, neuf, ne sauraient être de bons amis. Ils sont pour ainsi dire de soi des ennemis. », Carl Schmitt, Théologie politique, Gallimard, Paris, 1988, p.177
(19) T. Todorov, 2003, p.66


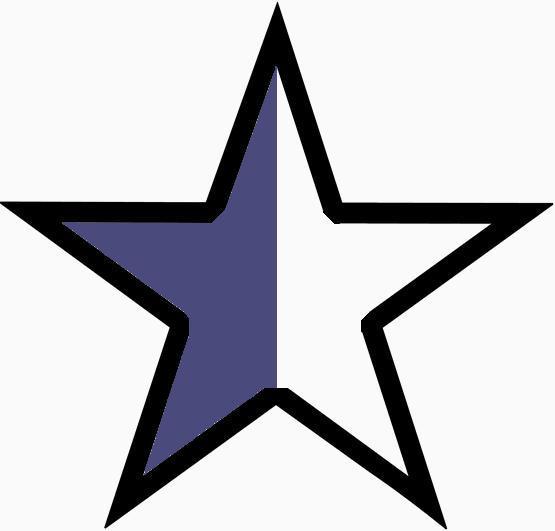



 Actualités
Actualités













